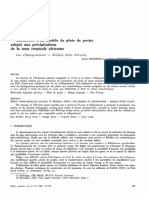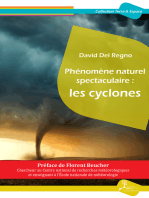Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Vortrag Christian Sacre
Vortrag Christian Sacre
Hochgeladen von
mohaCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Vortrag Christian Sacre
Vortrag Christian Sacre
Hochgeladen von
mohaCopyright:
Verfügbare Formate
Deutsches Komitee fr Katastrophenvorsorge e. V.
24 26 Mars 2003
LE RISQUE VENT: L'ENSEIGNEMENT DES TEMPETES DE 99
C. Sacr Centre Scientifique et technique du Btiment Dpartement Climatologie, Arodynamique, Pollution et Epuration
1 rappel des vnements mtorologiques
Reprenons les termes du communiqu internet de Mto France pour dcrire les deux temptes exceptionnelles qui ont balay la France la fin du mois de Dcembre : 1.1 L'OURAGAN DU DIMANCHE 26 DECEMBRE Des vents d'une violence exceptionnelle ont accompagn la trs profonde dpression (960 hPa 7 h aux environs de Rouen) qui a travers de part en part et trs rapidement le nord du pays dimanche matin 26 dcembre 1999. La trajectoire de cette dpression suit douest en est une ligne approximative le long du 49e parallle. elle s'est dplace environ 100 km/h. Outre les vents exceptionnellement fort mesurs dans l'intrieur des terres, cet ouragan est exceptionnel par le creusement de la dpression qui s'est accentu sur terre 1.2 L'OURAGAN DE LA NUIT DU LUNDI 27 DECEMBRE AU MARDI 28 DECEMBRE Cette deuxime dpression (trs profonde), se dplaant aussi une vitesse proche de 100 km/h, a travers le pays de l'aprs-midi du lundi 27 dcembre la nuit de lundi 27 mardi 28 dcembre. Elle s'est creuse en matine du lundi 27 au large de la Bretagne, a atteint en son centre 965 hPa en rentrant sur la pointe sud de la Bretagne vers 16 h locales. La trajectoire a suivi une ligne : Nantes vers 19 h locales, puis Romorantin vers 22 h locales, Dijon vers 1 h du matin le mardi 28,. La dpression sest ensuite vacue vers lest.Des vents exceptionnellement violents ont accompagn cette dpression, avec des forces maximales sur sa partie ouest et sud.
2 vitesse moyenne, vitesse de pointe, vitesse de rfrence
2.1 LES OBSERVATIONS DE METEO FRANCE Depuis 1949 et pour prs de la moiti des stations, les donnes de vitesse de vent disponibles dans la base de donnes de Mto France, sont la vitesse moyenne et sa direction associe
pour les 8 observations synoptiques journalires, ainsi que la vitesse de pointe maximale de la journe avec la direction correspondante. La vitesse moyenne est calcule sur les dix minutes qui prcdent chaque heure synoptique. La vitesse de pointe maximale journalire est gale au maximum de la vitesse instantane vue par l'anmomtre au cours de la journe, elle correspond, compte tenu de la courbe de rponse des anmomtres standard de Mto France une rafale d'une dure de 1 2 secondes. La direction du vent est donne par classe de 20. La connaissance de la vitesse moyenne du vent toutes les trois heures ne permet pas d'en dduire la vitesse moyenne maximale atteinte entre deux valeurs enregistres ; par contre la vitesse de pointe maximale journalire est bien une valeur reprsentative de la vitesse maximale atteinte par le vent au cours de la journe. Depuis quelques annes, Mto France enregistre galement la vitesse moyenne maximale journalire. Les vitesses observes dans les diffrentes stations mtorologiques doivent tre comparer conditions identiques. Or, la force du vent dpend de l'environnement proche du lieu o il est observ et bien videmment, chaque station a un environnement spcifique ; il faut donc corriger les vitesses de vent pour les ramener des conditions de rfrence. Cette correction ne peut tre effectue qu' partir des vitesses moyennes qui sont les seules variables du vent au sol transposable d'un site un autre. 2.2 VITESSE MOYENNE, VITESSE DE POINTE La vitesse de pointe V mto et vitesse moyenne V mto observes au cours d'une mme priode Tm sont statistiquement lies par une relation du type : V V mto = mto Gmto G mto est le coefficient de rafale, caractristique du site de la station, 2.3 LA VITESSE DE REFERENCE On dfinit par convention mais aussi par commodit parce que l'environnement des stations mtorologiques s'en rapproche souvent, la rase campagne comme le site de rfrence et donc la vitesse moyenne de rfrence Vref comme tant la vitesse moyenne du vent observable 10
m de hauteur dans un site plat et sans obstacle de rugosit de type rase campagne ( z 0,ref = 0.05 m ).On notera que Gref = 1.54 .
Cependant l'environnement des sites mtorologiques est rarement homogne ; chaque site est ainsi caractris dans un rayon de quelques kilomtres par sa position dans le relief (colline, valle ...), la nature du terrain (rpartition gographique des zones urbaines, de la rase campagne, des tendues d'eau ...) et dans un rayon de quelques centaines de mtres par la prsence ou non d'obstacles proches (haies, arbres, maisons ...). La prise en compte de ces lments physiques dans l'estimation de la vitesse moyenne du vent V ref peut se traduire par la dfinition de trois coefficients de perturbation par rapport la vitesse mesure V mto : V mto C R .CT .C S C R est le coefficient de Rugosit, CT est le coefficient de Topographie, C S est le coefficient de Sillage. Le CSTB a slectionn ainsi en 1992, 80 stations dont l'environnement local pouvait assez facilement tre corrig. Vref =
3. STATISTIQUE DES VALEURS EXTREMES DE LA VITESSE DU VENT
3.1 DETERMINATION DE LA FONCTION DE REPARTITION DES VITESSES EXTREMES Pour respecter les proprits d'indpendance des vnements et d'homognit de la population. On a considre l'chantillon des valeurs maximales annuelles de la vitesse de pointe toutes directions confondues. L'idal serait de connatre le vent maximum observable en un lieu, malheureusement, la connaissance de cette valeur absolue n'est pas possible, la limite suprieure de la vitesse du vent en un point est inconnue. La seule mthode acceptable consiste estimer les vitesses de vent qui risquent d'tre atteintes partir des vitesses enregistres dans le pass en utilisant le calcul des probabilits : la valeur de calcul de la vitesse du vent va tre caractrise par une probabilit d'occurrence pour une priode de rfrence donne. Considrons la plus forte vitesse observe x au cours d'une anne, et F(X), sa fonction de rpartition calcule sur la base de l'ensemble des priodes unitaires dont on dispose ; par dfinition : F(X) = Prob (x<X) F(X) est la probabilit pour que la vitesse maximale x au cours d'une anne ne dpasse pas la valeur X. Inversement, la probabilit de dpassement de la vitesse X au cours d'une anne s'exprime par : P=1-F(X) On y associe gnralement la notion de priode de retour T qui est gale la valeur moyenne de la priode sparant deux dpassements de la vitesse X. T est donne par : 1 T= 1 F (X ) T s'exprime en nombre d'annes. La fonction de rpartition F(X) des vitesses maximales est ajuste par une loi de distribution dite des valeurs extrmes. C'est la loi de Gumbel (loi de type I) qui est gnralement utilise : Le rapport de C. Sacr (CSTB, EN-CLI 93.9) prsente une cartographie des vitesses moyennes extrmes de priode de retour 50 ans tablie selon la mthode expose ci dessus. 3.2 EVALUATION DE LA PERIODE DE RETOUR DES VITESSES OBSERVEES EN DECEMBRE 1999 Les observations de Mto France pour les deux temptes sont d'une part la vitesse moyenne maximale journalire Vmto et sa direction associe Dmto et d'autre part la vitesse instantane galement avec sa direction associe D . Les directions sont maximale journalire V
mto mto
dfinies par secteur de 10. La prise en compte de l'environnement local a t effectue la fois sur la vitesse moyenne maximale journalire et sur la vitesse de pointe maximale journalire qui n'a pas toujours eu lieu la mme priode de la journe. Ainsi : Vmto V 1 mto et Vref ,1 = Vref , 2 = C R CT C S C R CT C S Gmto Etant donn le caractre alatoire du coefficient g la valeur maximale de Vref ,1 et Vref , 2 a t retenue. La vitesse V ref , max 1, 2 reprsente donc la valeur de pointe thorique dduite des deux vitesses prcdentes : V ref , max 1, 2 = Max(Vref ,1 , Vref , 2 ) G ref
C'est la vitesse de pointe qui aurait t observe en moyenne 10 m de hauteur en rase campagne, au cours des temptes du mois de dcembre. Le plus souvent Vref , 2 est suprieur
Vref ,1 .
Le calcul de la priode de retour Ttemp correspondant la valeur Vref ,max 1, 2 est effectu par rapport la distribution des valeurs extrmes dtermine pour chaque station et dfinie par les coefficients de la loi de Gumbel : Les priodes de retour Ttemp vont de 1 3000 ans ce qui n'a plus de signification statistique compte tenu du fait que les distributions initiales ne sont bases que sur une quarantaine d'annes. Plus intressant dans le domaine de la construction est l'analyse pour chaque station du Vref ,max 1, 2 rapport correspondant la priode de retour T gale 50ans car la vitesse moyenne Vref ,T
Vref ,50 est la vitesse de rfrence de l'Eurocode 1 Actions du vent. La figure 1 donne les
courbes d'isovaleurs de ce rapport qui est gal au rapport des vitesses de pointes
V ref , max 1, 2 . V
ref ,T
Elle rappelle galement les courbes d'isovaleurs de Vref ,50 retenues pour la constitution de la carte vent de l'Eurocode .
3.3 LES
VITESSES DU VENT OBSERVEES PAR RAPPORT AU VENT DE L'EUROCODE ET DES REGLES NV 65 MODIFIEES 99
Il faut noter que l'usage de l'Eurocode permettrait d'valuer chaque vnement tempte par rapport la vitesse cinquantnale. La figure 1 met en vidence les rgions les plus affectes par les temptes du mois de V ref , max 1, 2 dcembre ; elles correspondent un rapport suprieur 1, et dont les maxima sont V
ref , 50
de l'ordre de 1.2. Le tableau 1 donne une chelle de correspondance moyenne entre les valeurs du rapport et les priodes de retour. V ref , max 1, 2 Tableau 1 : Priode de retour et valeur du rapport V
ref , 50
V ref , max 1, 2 V
ref , 50
0.90
0.95
1.05
1.10
1.15
1.20
T en annes
15
25
120
250
400
> 2000
On retiendra que dans la partie sud et est du bassin parisien et la rgion nord ouest Aquitaine la priode de retour a dpass 400 ans, ce qui ne reprsente en fait que 15 20 % d'accroissement de la vitesse de rfrence de priode de retour cinquantenale. Comparaison avec les rgles NV 65 modifies 99 Les Rgles NV 65 dfinissent le vent "normal" partir d'une statistique des vitesses de pointes maximales journalires; mais, du fait de l'existence d'une autocorrlation importante de cette srie des vitesses journalires (l'chelle de temps des temptes gnratrices de vent fort est de l'ordre de deux trois jours) il n'est pas possible de relier simplement le vent "normal" des NV 65 et le vent de rfrence de l'Eurocode. Le premier est bas sur la notion de dure de dpassement d'une certaine vitesse que cette dure corresponde un seul coup de
vent assez long ou plusieurs coups de vent de courte dure alors que le second est bas sur la dtermination de la probabilit de l'vnement "dpassement d'un seuil de vitesse" quelle que soit la dure de ce dpassement. Or c'est bien cette deuxime approche statistique qui nous intresse dans la logique de dimensionnement d'une construction en vue de la dtermination de son Etat Limite Ultime de ruine car si une construction est ruine aprs le dpassement d'un seuil de la vitesse du vent, peu importe la dure de ce dpassement tant donn que la construction sera dj dtruite ! Quant au vent "extrme" des Rgles NV 65, bien qu'il paraisse dfini, il ne l'est pas en ralit car personne n'est capable de donner une valeur numrique une vitesse dfinie comme... "la plus grande vitesse instantane laquelle la construction peut tre soumise durant sa vie normale". Nanmoins; du simple point de vue du niveau de vitesse et en moyenne gographique sur l'ensemble de la France (J. Bitry 97) : - le vent "normal" correspond une "priode de retour" de l'ordre de 5 ans (probabilit annuelle de l'ordre de 0,20) - le vent "extrme" correspond une "priode de retour" de l'ordre de 100 ans (probabilit annuelle de l'ordre de 0,01). Il est possible de calculer pour chaque station mtorologique en fonction de son V ref , max 1, 2 appartenance une zone de vent de la nouvelle carte des rgles NV 65, le rapport et V
ref , NV 99
de tracer des courbes d'isovaleurs comme la figure1. C'est l'objet de la figure 2 qui montre l encore un dpassement de l'ordre de 10 15 % dans la partie sud et est du bassin parisien et la V ref , max 1, 2 rgion nord ouest Aquitaine. Les rgions o le rapport est suprieur 1 V
ref , NV 99
correspondent du point de vue des rgles NV 65 rvises 99, principalement des zones de type 1 et 2 et trs peu en zone 3 (Normandie). En d'autre terme, une tempte exceptionnelle dans l'Est de la France (zone 1) devient seulement une trs forte tempte en Bretagne (zone 4)
LE CALCUL DE LA PRESSION DYNAMIQUE DE REFERENCE ET LA SECURITE"
"MARGE
DE
4.1 L'IMPORTANCE DE L'ENVIRONNEMENT LOCAL Les trente dernires annes ont vu un dveloppement important de la mtorologie des basses couches de l'atmosphre et en particulier de la structure du vent dans la couche limite atmosphrique. La trs grande importance de la notion de rugosit a t mise en vidence. La vitesse moyenne du vent est une fonction logarithmique de la hauteur au-dessus du sol z : u z V ( z ) = * ln 1 k z0 Les paramtres u * et z 0 peuvent tre obtenus exprimentalement. La longueur de rugosit z 0 est une caractrisation arodynamique du sol. Pour une mme vitesse au sommet de la couche limite atmosphrique et une mme hauteur au dessus du sol, la vitesse moyenne de l'coulement sera d'autant plus faible que la rugosit du site sera importante. La longueur de rugosit est une fonction de la nature de la surface du sol et de la gomtrie des obstacles qui s'y trouvent. Le tableau 2. prsente une gamme de valeurs exprimentales obtenues sur des sites homognes de grande extension horizontale (Wieringa, 1991, 1993).
Figure 1 vitesses de rfrence observes au cours des temptes du mois de dcembre 1999, rapportes aux vitesses de rfrence calcules localement (priode de retour cinquantnale)
r=
Vref max 1,2 Vref ,50
Vref eurocode en m/s
Tableau 2 longueurs de rugosit et coefficient ( z 0 ) Type de surface Longueur de rugosit zo Coefficient Rfrence (m) (z 0 ) mer, champ de neige, dsert sablonneux 0.0005 0.14 I mer par vent trs fort 0.005 0.16 II herbe rase 0.01 0.17 III champs ouverts cultivs 0.05 0.19 IV cultures hautes, rase campagne 0.10 0.20 V bocage et habitat dispers 0.25 0.21 VI bocage dense, zone pri-urbaine 0.50 0.22 VII centre des villes moyennes, fort 1.00 0.24 VIII centre des mgapoles, fort tropicale 2.00 0.25 IX Dans la pratique, les valeurs de la vitesse du vent auxquelles on peut se rfrer, sont en gnral mesures dans un environnement aroportuaire o la rugosit est plutt de type IV. Aussi on dfinit la vitesse mesure 10 m de hauteur en site homogne de rugosit z 0ref = 0. 05m comme une vitesse de rfrence :
10 ln z0 k ref Le problme est alors d'exprimer la vitesse du vent observable sur le site tudi en fonction de celle mesure la station mtorologique V ref , en supposant toutefois que la station mtorologique ne soit pas trop loigne du site o l'on veut connatre la vitesse du vent afin que la vitesse de l'coulement gostrophique soit identique au dessus des deux sites. La relation peut s'crire : z V ( z ) = ( z 0 ) V ref ln z 0 Le tableau 2 donne pour les diffrents types de rugosit les valeurs du coefficient correspondant la rugosit de rfrence z 0ref = 0. 05 calcules l'aide de la formule approche Vref = u*ref
( )
propose par ESDU (82026) ( 3 % prs) L'application de cette formulation montre qu'en site de rugosit homogne, les vitesses moyennes du vent prsentent des diffrences importantes selon le type de rugosit. Ainsi 20 m de hauteur la vitesse moyenne en bordure de mer par vent fort est gale 1.17 fois la vitesse moyenne la mme hauteur en site de rfrence rase campagne, par contre en zone urbaine ce rapport est gale 0.63. Le coefficient de rafale est plus grand en zone urbaine (1.95) qu'en rase campagne (1.48) et a fortiori qu'en bordure de mer (1.34) la mme hauteur au dessus du sol (20 m). En consquence, la vitesse de pointe observable 20 m de hauteur sur le site urbain sera gale 0.83 fois celle observable en rase campagne et la vitesse de pointe en bord de mer sera 1.06 fois plus forte.
4.2 LA TRADUCTION DANS LE CALCUL DE LA PRESSION DYNAMIQUE DE REFERENCE La pression dynamique de rfrence Qref exprime en daN/m est dduite de la vitesse de rfrence donne en m/s par la relation = 1 V 2 avec = 1.225 kg / m 3 Q ref ref 2
La prise en compte de l'effet de rugosit dans les rgles NV 65 intervient avec l'effet de hauteur qui traduit l'augmentation de la vitesse du vent avec la hauteur H exprime en m au dessus du sol : Q H + 18 ref , H = 2.5 H + 60 Q
ref
Et la notion de site expos au voisinage de la mer sur une profondeur de 6 Km (coefficient k s de 1.2 1.35 selon les zones de vent). Q ref , site = Qref , H k s Dans le cas de l'Eurocode le coefficient d'exposition ( Qref = C e ( z ) , appliqu
Qref
1 2 Vref ), permet de passer de la pression dynamique moyenne de rfrence, 2 correspondant aux conditions normales de mesures mtorologiques, la pression dynamique de pointe, dans le site de construction et la hauteur z au dessus du sol. Il tient compte de la topographie du site de construction et de sa rugosit : 2 2 Q ref , site = C e ( z ) Qref avec C e ( z ) = C r C t + 7 ( z 0 ) C r C t En site plat (ou de pente infrieure 5 %), c'est--dire dans les cas courants, Ct = 1 . Les cas de topographie marque ne sont pas examins ici. Le paramtre Cr (z ) dpend de la rugosit du site: z C r ( z ) = ( z 0 ) ln z 0 Une comparaison entre Eurocode et Rgles NV 65 (J. Bietry 97) montre que les pressions dynamiques de pointe calcules par NV 65 sont sensiblement suprieures l'Eurocode, en ce qui concerne les constructions en bord de mer .Les Rgles NV 65 conduisent peu prs aux mmes valeurs que l'Eurocode pour les constructions en rase campagne ; mais, pour les constructions ralises dans des zones urbaines, suburbaines ou industrielles, la prise en compte de la rugosit du terrain par l'Eurocode conduirait une rduction importante. Dans les sites de forte rugosit (zones urbaines, industrielles, forestires), le vent est frein par les obstacles au sol. Les Rgles NV 65 ignorent cet effet rducteur des actions du vent.
4.3 UNE MARGE DE SECURITE Entre les actions "extrmes" des NV 65 et les actions "normales" il y a un rapport 1.75. Le calcul avec le vent "normal" correspond aux tats limites de service. Les vrifications l'Etat Limite Ultime dans les rgles NV 65 sont faites avec le vent "extrme" sans pondration. Les actions du vent calcules sur la base des pressions dynamiques Q ref , site ,dans l'Eurocode
sont des actions "caractristiques", c'est--dire qu'elles sont destines tre pondres par un coefficient suprieur l'unit ( = 1.5 ) dans les vrifications l'Etat Limite Ultime. En
a t infrieur 1.5 sur toute la France, on peut conclure que du point de vue de l'Eurocode les charges n'ont pas dpasses celles correspondant l'Etat Limite Ultime Le cas des rgles NV 65 est plus flou. Il n'y a pas de pondration "officielle" , cependant, le fait de ne pas tenir compte de la rugosit de l'environnement proche correspond de fait une pondration car les constructions sont bel et bien protges par leur environnement, en particulier en zone urbaine . Pour reprendre l'exemple du paragraphe prcdent, 20 m de V ref , max 1, 2 observant qu'au cours des temptes de dcembre 99 le rapport V ref ,50
2
1 hauteur en ville, le coefficient de pondration virtuel serait de 1.45 = (0.83)2 . Par contre en rase campagne ce coefficient est gal par dfinition l'unit, aussi les charges relles au cours des temptes de dcembre ont du y dpasser les charges correspondant l'Etat Limite Ultime.
5 CONCLUSION: L'INFLUENCE DE LA RUGOSITE DANS LES DEGATS CONSTATES AU COURS DES TEMPETES DE DECEMBRE 99
Le nombre de dossiers analyss a t de 551 dont une trs forte proportion en rgion 2 des rgles NV 65 carte 99 mais la rpartition gographique des dossiers n'est pas statistiquement significative .. L'environnement des constructions ayant subi des dgts a t qualifi l'aide de quatre types de rugosit: La mer, la rase campagne, la banlieue et la ville. Leur analyse conduit trois remarques Les btiments situs en rugosit mer et rase campagne ont subi plus de dgts leur structure et leurs revtements extrieurs que les btiments situs en zone plus forte rugosit. Cette constatation confirmerait la faiblesse des rgles NV 65 en rase campagne. Les btiments situs en rugosit ville et banlieue ont subi plus de dgts leurs fermetures et menuiseries que les btiments situs en zone plus faible rugosit. On peut se poser la question d'un plus grand tat de vtust des fermetures en ville qui pourrait expliquer ce fait. La proportion de toitures et couvertures endommages par rapport au parc total ne prsente pas de tendance par rapport au type de rugosit de l'environnement.
BIBLIORAPHIE -J. WIERINGA, 1993 "Representative roughness parameters for homogeneous terrain" Boundary Layer Meteor, 63, 323-363 -C. SACR, 1993 "Estimation des vitesses extrmes du vent en France mtropolitaine" Note CSTB EN CLI 93.9 R -J. BIETRY, 1995 "Le vent et ses effets sur les constructions : bases, volutions rcentes et rgles de calcul" CSTB EN-D 95.8 L -C. SACR, 2000 "Caractrisation des vitesses du vent observes au cours des temptes des 26, 27 et 28 dcembre 1999 du point de vue de la statistique des vitesses extrmes du vent pour la France mtropolitaine" CSTB EN-AEC 00.26 C -Rgles NV 65 modifies 99 et N 84 modifies 95 Rgles dfinissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes Editions Eyrolles -Eurocode 1 : Basis of design and actions on structures Part 2-4 : Actions on structures Wind actions, ENV 1991-2-4
Das könnte Ihnen auch gefallen
- AssainissementDokument13 SeitenAssainissementMoussa El MansouriNoch keine Bewertungen
- Examen Hydrologie Mai 2002 CorrigéDokument5 SeitenExamen Hydrologie Mai 2002 CorrigéOmar_FSO84% (32)
- Calcul de Bassin Versant UtileDokument6 SeitenCalcul de Bassin Versant UtileAnonymous DjA2T2I2Noch keine Bewertungen
- Clim An97Dokument6 SeitenClim An97simoNoch keine Bewertungen
- Cours HydrologieDokument30 SeitenCours Hydrologiefew100% (3)
- Hydrologie UrbaineDokument7 SeitenHydrologie Urbainelimmoud100% (1)
- TP 2 Hydrologie-Mesure Des PrecipitationsDokument7 SeitenTP 2 Hydrologie-Mesure Des PrecipitationsAbdu KadirNoch keine Bewertungen
- Chap2 - Methodes DynamiquesDokument27 SeitenChap2 - Methodes DynamiquesAhina AdrinkayeNoch keine Bewertungen
- ETOMONTDokument12 SeitenETOMONTfetrasoa3969Noch keine Bewertungen
- Chapitre 2 l3Dokument18 SeitenChapitre 2 l3Abdelhani MoussaouiNoch keine Bewertungen
- Examen Hydrologie Mai 2002 Corrige PDFDokument5 SeitenExamen Hydrologie Mai 2002 Corrige PDFDmitr100% (2)
- Evaluation Q Eaux PluvialesDokument22 SeitenEvaluation Q Eaux PluvialesRida JadiNoch keine Bewertungen
- Hydrogeologie1 Les PrecipitationsDokument7 SeitenHydrogeologie1 Les Precipitationscephas NtonkokaNoch keine Bewertungen
- BE2.1 EnoncéDokument2 SeitenBE2.1 Enoncérawaa elouastiNoch keine Bewertungen
- Meteo Lpro 12Dokument83 SeitenMeteo Lpro 12Khaled NaasNoch keine Bewertungen
- Actions Du Vent Sur Les StructuresDokument11 SeitenActions Du Vent Sur Les StructuresMohsen Tennich100% (1)
- Chapitre 3 La Houle RéelleDokument46 SeitenChapitre 3 La Houle RéellebouraadaNoch keine Bewertungen
- Questions Types HydrologiesDokument5 SeitenQuestions Types HydrologiesFabriceNoch keine Bewertungen
- TP#01 h18 Cartographie Guide 1Dokument13 SeitenTP#01 h18 Cartographie Guide 1Leonel Jospin MbambaNoch keine Bewertungen
- HA0803 Corrige PDFDokument8 SeitenHA0803 Corrige PDFGgNoch keine Bewertungen
- Elements Et Facteur ClimatDokument5 SeitenElements Et Facteur ClimatnejlaNoch keine Bewertungen
- 0 Pluviomé TrieDokument9 Seiten0 Pluviomé TrieMar OuaNoch keine Bewertungen
- CM Cours3 2020 2021Dokument75 SeitenCM Cours3 2020 2021somaya ehNoch keine Bewertungen
- Hydra LogieDokument10 SeitenHydra Logieبرحال زاكيNoch keine Bewertungen
- Chapitre 2 Distribution Du Vent PDFDokument12 SeitenChapitre 2 Distribution Du Vent PDFZino MohNoch keine Bewertungen
- TemsiDokument9 SeitenTemsibelarbiNoch keine Bewertungen
- Mesages Météorologiques 2Dokument6 SeitenMesages Météorologiques 2aabkaalNoch keine Bewertungen
- Assainissement UrbainHU911 M2 HU - 2021Dokument21 SeitenAssainissement UrbainHU911 M2 HU - 2021Amel HydNoch keine Bewertungen
- NV65Dokument5 SeitenNV65dabestgerbsNoch keine Bewertungen
- Chapitre IV - Hydrologie UrbaineDokument10 SeitenChapitre IV - Hydrologie UrbainePaulin Stanislas Kiswendsida ZongoNoch keine Bewertungen
- Cours Hydrologie 2 PDFDokument8 SeitenCours Hydrologie 2 PDFRealmak Awa100% (1)
- Exa 2002 2 PDFDokument5 SeitenExa 2002 2 PDFOmar OubahaNoch keine Bewertungen
- Mesure Et Etude Des Precipitations en Hydrologie: Deust - Genie Hydro Sanitaire Et AquacoleDokument38 SeitenMesure Et Etude Des Precipitations en Hydrologie: Deust - Genie Hydro Sanitaire Et AquacoleDziwonu AgbeNoch keine Bewertungen
- Les PrecipitationsDokument14 SeitenLes PrecipitationsYvan NgueyemNoch keine Bewertungen
- Cartographie PDFDokument87 SeitenCartographie PDFYoucefLiliNoch keine Bewertungen
- Hydrologie GénéraleDokument5 SeitenHydrologie Généralechaimae elmakrouzNoch keine Bewertungen
- Chapitre 4 Pluviom Etrie: Essat Prive-GabesDokument16 SeitenChapitre 4 Pluviom Etrie: Essat Prive-GabesKarim AbdelkrimNoch keine Bewertungen
- Les Facteurs Climatiques PPT 3Dokument40 SeitenLes Facteurs Climatiques PPT 3youssfeejjNoch keine Bewertungen
- TD N°03-ECOLOGIE-Belhadj Et al.-UYFM-2019-2020Dokument18 SeitenTD N°03-ECOLOGIE-Belhadj Et al.-UYFM-2019-2020Wafaa ZerarkaNoch keine Bewertungen
- Rapport Etudes TalwegDokument14 SeitenRapport Etudes Talwegkonate.madou20Noch keine Bewertungen
- Regime ThermiqueDokument5 SeitenRegime ThermiqueferhatiNoch keine Bewertungen
- Capture D'écran . 2024-05-12 À 07.22.23Dokument2 SeitenCapture D'écran . 2024-05-12 À 07.22.23boehly05Noch keine Bewertungen
- TD Climat-21-22 - Section HDokument25 SeitenTD Climat-21-22 - Section Hsoumya lidili100% (1)
- TextDokument4 SeitenTextEphraïm GibendeNoch keine Bewertungen
- Guide Calcul HydraulogiqueDokument8 SeitenGuide Calcul HydraulogiqueMohamed Kahlaoui0% (1)
- Chapitre 3. LES PRECIPITATIONSDokument9 SeitenChapitre 3. LES PRECIPITATIONSaloys NdzieNoch keine Bewertungen
- M1OACDokument6 SeitenM1OACmbayang ndiayeNoch keine Bewertungen
- Chapitre 2. Assainissement PluvialDokument22 SeitenChapitre 2. Assainissement PluvialNIMANNoch keine Bewertungen
- Eolienne Rotor Pales PuissanceDokument5 SeitenEolienne Rotor Pales PuissanceSofian SalmaniNoch keine Bewertungen
- Le Bassin VersantDokument2 SeitenLe Bassin VersantAsma ElbrikeNoch keine Bewertungen
- Cours Dispersion 23 Nov 2010 HSF FinalDokument86 SeitenCours Dispersion 23 Nov 2010 HSF FinalbentouamiNoch keine Bewertungen
- Rech Pluie Projet Adaptée Zone Tropic AfricDokument9 SeitenRech Pluie Projet Adaptée Zone Tropic AfriccedNoch keine Bewertungen
- Assainissement GravitaireDokument13 SeitenAssainissement GravitaireOmar_FSONoch keine Bewertungen
- Géothermie: Les Grands Articles d'UniversalisVon EverandGéothermie: Les Grands Articles d'UniversalisNoch keine Bewertungen
- EnqueteDokument1 SeiteEnqueteMoez AlouiNoch keine Bewertungen
- Cetose Diabetique InauguraleDokument47 SeitenCetose Diabetique InauguraleFouad TahriNoch keine Bewertungen
- Fiche Logique CombinatoireDokument4 SeitenFiche Logique Combinatoireayoub elNoch keine Bewertungen
- Machine AsynchroneDokument11 SeitenMachine AsynchroneTarak BenslimaneNoch keine Bewertungen
- Chap 2 E-ReputationDokument28 SeitenChap 2 E-ReputationJoye Gilford IDZANDO BONDANoch keine Bewertungen
- Le Resume de L Explication Du Livre de L Unicite.01Dokument143 SeitenLe Resume de L Explication Du Livre de L Unicite.01Abdallah ibn aliNoch keine Bewertungen
- 9 Normal Varianta 2Dokument4 Seiten9 Normal Varianta 2Cristina MarinNoch keine Bewertungen
- Manuel Cooperation SteinerDokument19 SeitenManuel Cooperation SteinerKarimNoch keine Bewertungen
- Précipitation de La Phase Sigma Et Des Carbures de Chrome Dans Les Soudures D'acier Inoxydable Duplex 2205Dokument95 SeitenPrécipitation de La Phase Sigma Et Des Carbures de Chrome Dans Les Soudures D'acier Inoxydable Duplex 2205presleNoch keine Bewertungen
- Pourquoi La Protéine Spike Est Toxique Dans Le COVID-19... Et Aussi Dans Les Vaccins ARNm Et ADNDokument1 SeitePourquoi La Protéine Spike Est Toxique Dans Le COVID-19... Et Aussi Dans Les Vaccins ARNm Et ADNAdama DIARRANoch keine Bewertungen
- Exo RedDokument2 SeitenExo Redwijdane imerNoch keine Bewertungen
- College de Paris MBA Supply Chain SG v11 4hDokument268 SeitenCollege de Paris MBA Supply Chain SG v11 4hAhmed DjaouchiNoch keine Bewertungen
- Adomania4-Projet Moteur-EnsDokument3 SeitenAdomania4-Projet Moteur-EnsionikaNoch keine Bewertungen
- Louvre La Liberte Guidant Le Peuple Dossier DocumentaireDokument11 SeitenLouvre La Liberte Guidant Le Peuple Dossier DocumentaireMiguel Ángel Martínez.Noch keine Bewertungen
- My Hope Is Jesus SMDokument11 SeitenMy Hope Is Jesus SMLucas BritoNoch keine Bewertungen
- PLASSARD, Didier - L'auteur Et Le Metteur en Scène - Aperçus D'un CombatDokument23 SeitenPLASSARD, Didier - L'auteur Et Le Metteur en Scène - Aperçus D'un Combatluiz claudio CandidoNoch keine Bewertungen
- 4.transmission de DonneesDokument4 Seiten4.transmission de DonneesAdamou Daouda MahamadouNoch keine Bewertungen
- 16 - Live Coding - Créer Un Site Multilingue Avec Symfony 4Dokument8 Seiten16 - Live Coding - Créer Un Site Multilingue Avec Symfony 4BOVIC OLIVIERNoch keine Bewertungen
- Pathologie Endodontique3Dokument27 SeitenPathologie Endodontique3fethi42100% (1)
- Econometrie Mohamed EL RhendorDokument18 SeitenEconometrie Mohamed EL RhendorWarrenNoch keine Bewertungen
- Section: Sciences Experimentales: 10 Sujets de Révision (Bac 2018)Dokument258 SeitenSection: Sciences Experimentales: 10 Sujets de Révision (Bac 2018)maxrxmNoch keine Bewertungen
- Manuel D'examens D'en-2020Dokument102 SeitenManuel D'examens D'en-2020MARYEM CHOUKRINoch keine Bewertungen
- Геров Б Западнотракийските Земи ІІІ 1969Dokument67 SeitenГеров Б Западнотракийските Земи ІІІ 1969Plamen RPNoch keine Bewertungen
- Preeclampsie NouvDokument14 SeitenPreeclampsie NouvWOGNIN100% (1)
- Ebook Ramadan Musulman Productif Livre Islam Ebook Islam PDFDokument37 SeitenEbook Ramadan Musulman Productif Livre Islam Ebook Islam PDFMusulmanProductif.com100% (1)
- Histoire Ordonner Des FaitsDokument2 SeitenHistoire Ordonner Des FaitsLamineNoch keine Bewertungen
- DevoirDokument2 SeitenDevoirAYADI IMEDNoch keine Bewertungen
- Questions Sur La Belle Et La BêteDokument1 SeiteQuestions Sur La Belle Et La BêteevaNoch keine Bewertungen