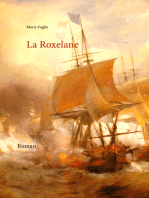Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
30 Oct 09 CANABADY Reunion - de La Côte Malabar À Mon
Hochgeladen von
magic630 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
876 Ansichten10 SeitenOriginaltitel
30 Oct 09 CANABADY Reunion - De la côte Malabar à Mon
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
RTF, PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
Als RTF, PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
876 Ansichten10 Seiten30 Oct 09 CANABADY Reunion - de La Côte Malabar À Mon
Hochgeladen von
magic63Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
Als RTF, PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 10
De la côte Malabar à Mon-Caprice
CLICANOO.COM | Publié le 1er janvier 2005
Une dizaine d’années après l’abolition de l’esclavage, un certain
Saminadin Moutien Ganapathy quitte la côte Malabar pour
rejoindre le domaine de Gabriel Le Coat de Kerveguen à Mon-
Caprice et honorer son contrat d’engagement de cinq ans. Un
siècle et demi plus tard, son arrière-petit-fils Gilbert Canabady
Moutien a réussi à la sueur de son front à devenir propriétaire
du domaine sur lequel il a versé la sienne.
Le 25 octobre 1857 (à moins que ce ne fût quelques mois avant ou
quelques mois après, - faute de passeur de mémoire), après une
interminable traversée de l’océan Indien suivie d’une dizaine de jours
de quarantaine en rade de Saint-Denis, le “Canova” (sinon la
“Marguerite”, peut-être le “Sanassy” ou pourquoi pas le “Palladium” ?,
personne n’est plus là pour s’en souvenir) accoste au pont-
débarcadère de la Grande-Chaloupe (ou à celui de la ravine à
Jacques). Le navire débarque près de 400 Indiens, qui sont montés à
bord dans le port du comptoir français de Pondichéry (ou à Yanaon,
Karikal, Mahé ou Madras, ou encore Bombay, eux-mêmes ne le
savaient pas pour n’y avoir jamais été), rassemblés par des
recruteurs d’une de ces agences d’immigration indienne dans les
villages les plus reculés de la côte de Malabar ou de Coromandel.
Quelques-uns de leurs frères ont péri au cours de la traversée, sans
savoir qu’ils ont eu de la chance par rapport aux survivants. Parmi
ceux-ci, Saminadin Moutien Ganapathy (francisé en Canabady). Est-
il célibataire ? Une épouse l’accompagne-t-elle, engagée comme lui ?
Selon certaines sources, il épousera bien plus tard à la mairie de
Saint-Pierre une cultivatrice de Mon-Caprice, Sinama Candapin,
arrivée elle vers 1855. Quel âge a-t-il ? Le sait-il lui-même ? Peu
importe. Il a la force de la jeunesse, et, l’aventure le tente : le
recruteur ne lui a-t-il pas fait croire que le pays où il l’emmène
regorge d’or ? En réalité, en cette année 1857 où la canne grimpe à
l’assaut des terres encore en friches, il vient louer ses bras. Tout
comme 1 448 autres engagés introduits dans l’île cette année-là. Son
contrat de cinq ans renouvelable (qu’il ne sait pas lire, étant illettré)
indique qu’il est affecté à la propriété de M. le comte Gabriel Le Coat
de Kerveguen à Mon-Caprice. La famille (ou plutôt la dynastie)
Kerveguen possède le plus immense domaine foncier que la Réunion
ait jamais connu. À l’apogée de sa puissance, elle est propriétaire de
pratiquement toutes les terres qui s’étendent dans le Sud entre 150
m et 800 m d’altitude, soit près de 12% de la surface totale de l’île.
L’engagement des Indiens suscite un véritable engouement. Des
maisons de commerce se chargent des recrutements, mais laissent
les modalités pratiques à des intermédiaires (surnommés “duffadars”
par les Indiens et “kidnappers” par les Anglais). En effet, ces
recruteurs usent de méthodes plutôt douteuses, n’hésitant pas à
tromper les candidats sur leurs futures conditions de travail et de
rémunération et recourent parfois même à de vrais enlèvements ou à
des engagements forcés. Le contrat de travail signé en Inde est
aussitôt revendu aux colons engagistes. Le “coolie” engagé à
Calcutta est acheminé à Maurice ou à Bourbon sur un entrepont de
bateau et dans des conditions de transport identiques à celles des
esclaves, les fers en moins.
Traités comme des esclaves Confiant, Saminadin est loin de se
douter de la nouvelle vie qui l’attend. Il a laissé dans son village ses
vieux parents, une flopée de frères et de sœurs plus petits et a
promis de leur envoyer cet argent qu’il compte économiser et qu’ils
attendent déjà pour continuer de survivre. Beaucoup de ses
connaissances ont avant lui fait le même voyage. Certains
appartenaient à son village natal. Que sont-ils devenus ? Il espère les
retrouver dans cette île qu’on dit minuscule par comparaison avec le
vaste subcontinent d’où ils viennent. Quel est la situation dans l’île en
cette année 1857 ? Depuis le 20 décembre 1848, Sarda-Garriga a
proclamé la libération de tous les esclaves de l’île (qui sont alors au
nombre de 62 151, pour 40 433 Blancs et affranchis). Mais cette
abolition ne met pas fin à l’indignité faite aux hommes, puisque la
main d’œuvre servile que réclame l’activité sucrière en plein
développement en cette fin du XIXe siècle sera remplacée par celle
des engagés. Près de 110 000 recrutés dans les comptoirs français
de l’Inde anglaise puis les ports britanniques de la côte Sud du
subcontinent feront le voyage dans les cales de navires jusqu’à notre
île redevenue française - grâce à la courtoisie de l’Angleterre - depuis
le traité de Vienne en 1815, après avoir été une “Crown colony”,
entre l’arrêté du 3 juillet 1829 y réglementant l’introduction des
Indiens et le 19 décembre 1882 quand l’Angleterre dénoncera les
conventions signées avec la France le 25 juillet 1860 et les 1er juillet
1861 relatives à l’immigration indienne en direction de la Réunion,
parce que les engagistes bafouaient allègrement la réglementation.
Selon l’historien Yves Pérotin, c’est à la Réunion que le “coolie trade”
a débuté vraiment. Dès 1828, M. d’Arifat, un créole de l’île Maurice,
chargé de la construction du pont de la rivière des Roches, fait venir
de Pondichéry des travailleurs indiens. Bénéficiant de la double
nationalité indienne et britannique, ceux-ci étaient libres, recevaient
un salaire, mais étaient traités comme des esclaves, subissant
violences et privations de toutes sortes. En fait, les origines indiennes
des Réunionnais remontent à trois siècles et demi, au tout début du
peuplement de notre île, puisqu’en 1663 des colons blancs prennent
pour femmes légitimes des Indo-Portugaises (qui n’ont de Portugais
que la nationalité du pays colonisateur des comptoirs de l’Inde) de
Goa. À cette première vague d’émigration indienne succèdera celle
des esclaves (près de 10 000 entre 1674 et 1830) ramenés des Indes
sur des navires négriers une dizaine d’années plus tard, quand - bien
avant le code noir - le gouverneur Jacob de la Haye interdira le
mariage entre Blancs et Noirs... Saminadin n’est bien entendu pas
seul à rejoindre la propriété de “M. Le Coat de Kerveguen” (comme
on l’appelle) à Mon-Caprice, où quelque 300 ouvriers sont affectés
aux travaux des champs. Ils y cultivent essentiellement la canne, qui
est traitée à l’usine des Casernes, autre propriété des Kerveguen.
Leur habitat a changé par rapport à celui de leurs frères de misère de
la première époque. Perçus comme des étrangers culturels, ils sont
désormais rassemblés dans un camp composé de cabanons
collectifs. Ils travaillent entre onze et treize heures par jour, moins
environ deux heures pour les repas, reçoivent la nourriture
réglementaire et sont convenablement vêtus, bénéficient de soins
médicaux et leurs salaires sont payés régulièrement. La qualité de
leur travail est jugée plutôt bonne en général, même si cette classe
d’ouvriers agricoles est durement exploitée, pour un salaire de
misère, et que leur condition reste très proche de celle des anciens
esclaves.
Engagés pour cinq ans La gestion des ressources humaines de
“M. Le Coat de Kerveguen”, n’en déplaise à ceux qui colportent sur
lui la même légende noire que sur Mme Desbassayns, n’est ni
meilleure ni pire que celle des autres sucriers. Quel était exactement
le contrat d’engagement du jeune Saminadin ? Aucune trace écrite
n’a été retrouvée. Était-il identique à ce contrat datant du 16 mars
1828 parvenu jusqu’aux Archives départementales ? Un article y
stipule : “Nous serons entièrement libres de professer notre religion
et d’en faire les cérémonies, suivant les us et coutumes de notre
caste. Il nous sera permis, si nous le désirons, d’établir une petite
pagode.” Un autre article ajoute : “Nous serons exempts de travail le
jour du Pongol qui sera notre seule et unique fête et pour laquelle
nous prendrons quatre jours pour la célébrer.” Mais, bien que
reconnue depuis 1829, la culture des engagés ne sera que
partiellement respectée par le législateur colonial, car considérée
(surtout par les prêtres catholiques) comme “la religion du diable”.
Toutefois, comme l’écrit Firmin Lacpatia dans “Les Indiens de la
Réunion - La vie religieuse”, “pour retenir la main d’œuvre sur les
terres, les propriétaires poussent le zèle en l’aidant matériellement
dans leurs pratiques.” Saminadin s’est engagé pour une durée de
cinq ans, au terme desquels il peut rempiler ou rentrer chez lui. On
sait que les rapatriés étaient peu nombreux et que ceux qui
regagnaient l’Inde natale étaient prématurément vieux (la moyenne
d’âge des engagés se situait à 44 ans) ou estropiés, munis d’infimes
économies (quatre fois moins que ceux qui revenaient de Guyane
pourtant connue pour ses lamentables conditions de travail). Comme
s’ils avaient versé leur sueur pour rien ! De 1852 jusqu’à 1863, le
sucre connaîtra un second “boom” et la Réunion une décennie
prodigieuse. Le nombre des usines, qui était de 101 en 1851,
remonte à 125 en 1859. La commune de Saint-Pierre tient alors la
première place de l’île avec ses 19 usines. La base foncière est dans
le Sud : 5 199 hectares dont 2 895 hectares sur Saint-Pierre. Sur la
route du Tampon, la propriété de Mon-Caprice (qui produit 800
tonnes de sucre). Au début de l’activité sucrière des Kerveguen, les
Indiens sont presque inexistants (1,5 % des salariés), ce qui est aussi
conforme au modèle général. En 1847, ils restent toujours aussi peu
nombreux (2 %). D’après le dénombrement quinquennal de 1881,
c’est à Saint-Pierre qu’on trouve le plus grand nombre d’engagés
indiens : 6 347 pour 8 sucreries, sur un total de 30 634 travaillant
dans 55 sucreries (sur 46 454 engagés toutes origines confondues,
pour une population de 169 493 habitants). Officiellement, les
immigrants indiens constituent alors un quart de la population totale.
Au 31 décembre 1882, au moment où prend effet la suppression de
l’immigration indienne, la colonie en compte 45 526.
Un “calou”, un banian,... un temple Docile comme tous ses
compagnons venus de l’Inde, Saminadin ne semble pas se plaindre
de son sort. Il est à peu près certain qu’il a pu envoyer quelques sous
à sa famille restée au pays. Mais il n’aura pas réussi à économiser le
pécule nécessaire pour pouvoir retourner chez lui. Il travaille bien et
sait se faire apprécier. Aussi ses patrons lui conseillent-ils de signer
un nouvel engagement à l’expiration de son contrat. Il prendra du
galon et sera nommé commandeur. Ses enfants travaillent avec lui. Il
en aura neuf, qui quitteront Mon-Caprice vers 1918, quand le dernier
comte de Kerveguen envisagera de retourner en France Très
croyant, Saminadin trouve refuge dans la pratique de sa foi
religieuse. Dans son baluchon, n’a-t-il pas amené depuis son village
un “calou” ? Cette pierre symbolique en forme de lingam, il la place
dans la paillotte qui sert de chapelle. Une chapelle abritée par le
feuillage du banian, ce figuier de l’Inde aux longues racines
aériennes qui pendent jusqu’à terre, qu’il a planté lui-même. Est-ce
lui aussi qui façonne la statue de Ganesh, le dieu à tête d’éléphant et
à quatre bras, qui figure toujours aujourd’hui dans le temple réhabilité
depuis par son arrière-petit-fils Gilbert Canabady Moutien ? Nul ne
peut l’affirmer, mais c’est très vraisemblable. Son descendant Mardé
Moutien dit “Nono”, né en 1910, épousera à l’âge de 29 ans Annecy
Erambrompoullé dit “Ti-Soeur”, petite-fille d’un couple d’engagés
arrivés de l’Inde à peu près à la même époque que lui et s’étaient
installés du côté de Sainte-Marie, puis de Sainte-Suzanne. À savoir,
Maroudé Périamanompoullé, né en Inde en 1839, est arrivé à
Bourbon en tant que permissionnaire et était commerçant, et son
épouse Mary Viraye, cultivatrice. En même temps que Maroudé avait
débarqué deux amis, qui devaient par la suite arranger (comme cela
se pratiquait couramment à l’époque) le mariage de deux de leurs
enfants, Moutoussamy Candassamy Ponama et Goïndama Incana.
La fille de ce couple, Avayamba Candassamy Ponama, devait
épouser en 1903 le fils de Maroudé Périamanompoullé, du même
prénom que lui, Maroudé Erambrompoullé Périamanompoullé.
Venons-en à Gilbert Canabady Moutien. Il est l’aîné des neuf enfants
de “Nono” et de “Ti-Soeur”. Petit manœuvre mécanicien, il n’aurait
jamais imaginé ramener un jour dans le giron familial le site où ses
aïeux ont trimé. Dans les années soixante-dix, il commence par
racheter un bout du terrain toujours planté en cannes. Puis, d’autres
parcelles, jusqu’à posséder aujourd’hui la totalité du domaine de
Mon-Caprice. À notre connaissance, il s’agit de l’unique exemple à la
Réunion d’un descendant d’engagés à être parvenu à devenir
propriétaire de “l’habitation” sur laquelle des fils de l’Inde étaient
employés. Ses pensées toujours tournées vers leur pays natal, il
s’est dans le même temps attaché à obtenir la très convoitée carte
“Person of Indian origin” (qu’il est le premier dans l’île à avoir
obtenue, en tant que descendant d’engagés, grâce l’ex-consule
générale Banashri Bose-Harrison, en attendant la nationalité indienne
promise par l’ancien Premier ministre Vajpayee lors du 1er congrès
de la diaspora indienne (en janvier 2003, à New-Delhi, avec
confirmation cette année). Comme tous ses aïeux qui ont travaillé sur
le domaine de Mon-Caprice, Gilbert a planté un banian à côté des
leurs. Tous ces arbres forment aujourd’hui une masse monumentale
dont le feuillage abrite le temple des ancêtres, qu’en fils respectueux
il a réhabilité. À l’entrée de cet édifice, pour ponctuer les cérémonies,
il a placé la cloche que son grand-père, adolescent, sonnait à 3 h 45
chaque matin pour réveiller le camp, avant de descendre à pied
porter le lait à la famille Kerveguen qui résidait au château des
Casernes, pour remonter porteur du courrier et des directives du
propriétaire au gérant. Mission accomplie, lui qui vit quotidiennement
sur son domaine, Gilbert associe sa fierté toute légitime à celle de la
réussite de sa communauté, et délèguera l’administration du domaine
à son fils Gérard, passionné comme lui de généalogie et du travail de
la terre.
Le dieu qui “enlève tous les obstacles” Avant hier, une
monumentable statue de Ganesh, édifiée par des artisans de
Mahabalipuram, a été scellée à l’entrée du temple des ancêtres, au
cours d’une cérémonie spéciale.
Connu aussi sous les noms de Ganapathy, Ekadanta, Vinayaka,
Heramba, etc, dans différentes parties de l’Inde ou employés en
diverses occasions, Ganesha ou Ganesh (des deux mots sanskrits
“gana” et “îshah” qu’on peut traduire par le Seigneur des êtres, de
tout ce qui existe dans l’univers), le dieu nain obèse à tête d’éléphant
et doté de quatre bras, fils aîné de Shiva et de Parvati, est l’une des
divinités les plus populaires et les plus vénérées du panthéon hindou
et il est invoqué dans toute action même la plus ordinaire et surtout
dans n’importe quelle cérémonie rituelle. Dieu de l’harmonie
domestique (“Protecteur du foyer”) et du succès, il est celui que l’on
invoque avant toute entreprise, pour le prier de lever les obstacles.
Vénéré dans l’Inde entière par des foules immenses, comme par
chacun dans l’intimité de son foyer, son culte est familier, même si
des pratiques occultes de tantrisme existent aussi. La légende
raconte que Shiva, le destructeur dans la trinité hindoue, parti méditer
dans l’Himalaya, son épouse Parvati décide de créer quelqu’un pour
la protéger. Elle s’enduit le corps d’onguents, qu’elle utilise par la
suite comme d’une pâte pour sculpter une “murthi” (représentation)
d’enfant. Elle lui insuffle la vie et lui ordonne de surveiller la porte
pendant qu’elle accomplit ses ablutions et de ne laisser entrer
personne. Shiva revient le quatrième jour après l’apparition du
croissant de lune. Ganesh, qui, ne l’ayant jamais vu, ne le connaît
donc pas et lui interdit d’entrer. Shiva, en colère, finit par décapiter
l’enfant. Apprenant cela, Parvati le supplie de redonner la vie à
l’enfant. Shiva accepte et demande à ses fidèles d’aller prendre la
tête du premier être qu’ils rencontreront sur leur passage. Ce sera un
éléphant, dont greffe la tête sur le jeune corps décapité. Il insiste pour
que l’on prie le dieu Ganesh avant chaque prière. “Dans chaque
prière, on doit honorer Ganesh, le dieu qui enlève tous les obstacles”,
observent les fidèles... Ganesh symbolise aussi l’intelligence. Un jour,
Shiva et Parvati demandent à leurs fils, Ganesh et Kumarswami ou
Kartike d’effectuer un tour du monde. L’enjeu est de taille : une
bénédiction et la vénération assurée avant d’autres divinités. Kartike
a pour monture un paon et Ganesh un rat. Le premier s’empresse
d’accomplir son tour de la terre. Ganesh lui ne bouge pas. Ses
parents s’en inquiètent mais il demeure imperturbable. Quand il voit
son frère approcher, il se contente de tourner sept fois autour de son
père et de sa mère, montrant qu’à ses yeux ils constituent le monde.
C’est ainsi qu’il l’emporte sur son frère. L’anniversaire de Ganesh est
l’événement le plus joyeux de l’année dans l’ensemble de l’Inde, où il
est célébré avec beaucoup d’enthousiasme et de dévotion. Dans
l’Andhra-Pradesh et le Maharashtra, la fête de Ganesh-Chaturthi
(que certains appellent aussi Vinâyagar-Sadurthi) dure dix jours, les
dévots se préparent durant un mois par un jeûne et des chants
religieux quotidiens, les maisons sont nettoyées pour accueillir une
“murthi” le représentant, qui est porté en procession jusqu’à une
rivière ou la mer, symbole de pureté. Ils remercient la divinité de les
avoir maintenus en bonne santé et souhaitent qu’il en soit de même
l’année suivante. Ils prient aussi pour la paix.
Saint-Louis : Un haut lieu de la mémoire... à l’abandon Vivants, ils
ont souffert dans leurs cœurs et dans leurs chairs de l’exclusion.
Morts, ils continuent de souffrir de l’indifférence. Si les “âmes
délaissées” occupent une place privilégiée dans les croyances
populaires (il n’est que de constater la fréquentation du cimetière des
esclaves, au Gol, qui est un des plus fréquentés de l’île), celui “des
Malabars”, situé à l’arrière du cimetière catholique dit “des chrétiens”,
à Bel-Air (toujours à Saint-Louis), et qui abrite une centaine de
sépultures des premiers engagés indiens qui refusaient le baptême
chrétien, est de façon incompréhensible complètement à l’abandon.
Et ce depuis des décennies et des décennies. On avancera que, si
personne n’ose s’y aventurer, c’est à cause des superstitions qui ont
la vie dure. À moins que ce ne soit parce qu’il a été complètement
muré. Mais s’il a été muré, c’est justement... à cause des
superstitions. Toujours est-il que ce site historique, qui fait partie du
patrimoine indien de rite hindou, propriété de la commune, gagnerait
à être mis en valeur, pour en faire un haut lieu de la mémoire
collective et aider les jeunes générations à retrouver leur histoire et à
se la réapproprier. Le président du Groupe de recherche sur
l’archéologie et l’histoire de la terre réunionnaise, Marc
Kichenapanaïdou, depuis quelques années, y effectue un dépôt de
gerbes symbolique, à l’occasion du nouvel an tamoul. Et s’il se réjouit
de l’état d’abandon depuis si longtemps de ce “cimetière des
Malabars”, c’est parce qu’“il n’a pas fait l’objet de fouilles
intempestives et conserve ainsi tout son intérêt archéologique”, s’en
explique-t-il. Selon la tradition orale transmise par les personnes
âgées de Saint-Louis, jusqu’en 1876 y étaient enterrés les engagés
indiens qui ne pouvaient prétendre à être inhumés dans le même
cimetière que les chrétiens, parce qu’ils refusaient le baptême. Selon
des “anciens”, si aujourd’hui toute l’Inde brûle ses morts, à l’origine
les Dravidiens (qui l’ont colonisée bien avant les Aryens) les
enterraient, — avec tous les ustensiles et bijoux qu’ils aimaient. Or, la
majorité de nos compatriotes originaires de l’Inde sont... des
descendants des Dravidiens. Les engagés ont par conséquent bien
pu garder cette coutume ancestrale d’enterrer les défunts. D’autant
plus que la crémation était interdite...
Le culte de Draupathy Le culte de Draupathy-Amen (virginité) ou
Draupadi ou Dolvédée, qui appartient à la “trimurti” féminine avec les
déesses Maria-Amen (fidélité) et Karli-Amen (toute puissance), est la
marche sur le feu, spectacle de la foi des engagés indiens. Avant ce
rituel, se déroule — de façon théâtrale — le mariage de la déesse
avec Adjuna (“mariage bondié”). Selon la légende, le père de
Draupathy avait fixé une épreuve pour départager ses prétendants.
Seul Adjuna réussit à atteindre d’une flèche une cible au sommet
d’une perche en ne regardant que le reflet de l’objectif dans l’eau au
pied du mât. Chez lui, sa mère lui demanda de la partager avec ses
quatre frères. Obéissant, il accepta et la céda à tour de rôle à chacun
d’eux. Mais la légende veut que la femme déifiée est restée chaste.
Selon la version tamoule du Mahâbhârata, pour le prouver à chaque
fois qu’elle devait changer d’“époux”, elle traversa un brasier sans se
brûler.
Le temple des ancêtres réhabilité C’est l’histoire d’une grande
solidarité et aussi d’une grande souffrance, où chaque sou devait être
économisé (ce qui n’était pas toujours possible) et où la religion
synonyme de don total de soi à Dieu était le seul support moral.
À l’entrée du Domaine de Mon-Caprice, au bord de la route,
d’imposants banians abritent un temple tamoul. La date précise de la
fondation de cet édifice dédié à la déesse Draupathy reste inconnue.
Selon des souvenirs familiaux, approximativement entre 1850 et
1860. Il a été construit par les premiers engagés indiens qui
travaillaient dans le camp, conformément à leur contrat de travail qui
les autorisait à pratiquer leur culte ; le contrat précisait que le
propriétaire devait fournir bois, charbon et une certaine somme
d’argent pour la marche sur le feu. À l’époque de De Kerveguen —
dont les terres, à l’apogée de sa puissance foncière, couvraient un
tiers des sols cultivables de l’île — Mon-Caprice était un des
principaux centres de la vie économique et sociale du domaine de
Basse-Terre (limité au Nord par la ligne des 400 et s’étendant de la
rivière d’Abord à la ravine Blanche sur un peu plus de 308 hectares).
Le temple originel se situait sur un promontoire rocheux inculte “où
ne passait pas le soc à charrue” et était en terre, en paille et en
roches. Au début du XXe siècle jusque dans les années trente (1927-
28, selon les souvenirs familiaux), les cérémonies religieuses s’y
déroulent régulièrement. Puis, sous les pressions du clergé local, les
processions et notamment les marches sur le feu seront interdites.
Dès lors, le petit temple sombre dans un état déplorable, avec une
couverture sommaire de paille. Le service religieux est cependant
pratiqué en cachette certains dimanches de l’année, dans la crainte
de la délation. En fait, l’activité religieuse se déplace vers les temples
de Ravine-des-Cabris, Saint-Louis, voire Saint-Paul. Après le cyclone
de 1948, l’évolution aidant et les propriétaires ayant changé, le toit du
temple sera refait en tôles et la marche sur le feu retrouve droit de
cité jusqu’en 1950. La vie religieuse redevient chaotique pendant
vingt ans et les clés de l’édifice sont gardées arbitrairement par les
propriétaires. Le temple a retrouvé son activité depuis que Gilbert
Canabady Moutien a racheté la propriété. • Les cérémonies
d’aujourd’hui dimanche (“bahnou va’ram”), 13e jour (“da’rana
varusham”) du 5e mois lunaire d’Aavani et 10e jour (“dasami”) de la
lune croissante (“soukla patcham”) se dérouleront comme suit : 7 h
30, yagasala pooja yaagam ; 8 h-9 h, Maha Ganapathy
kumbabishegam ; repas végétarien. Les offices seront célébrés sous
l’autorité du swami S. Nagaraja Sivachariyar Gurukkal.
• La marche sur le feu initialement prévue pour le mercredi 14 juillet a
été reportée à la fin du mois d’août.
De Mahabalipuram à Mon-Caprice Gilbert Canabady Moutien a fait
apposer l’inscription suivante à l’entrée du temple : “Loin de leur terre
natale, sur ces pierres, les engagés indiens ont bâti dans la
souffrance leur temple, symbole de leur fidélité à la religion
ancestrale. La sacralisation de Ganesh auprès de ce temple est un
hommage à leur courage et leur dévouement. Cette divinité est
érigée en souvenir de tous ceux qui, à l’époque, sont venus travailler
la terre et n’ont pu retourner au pays. Elle est posée face au soleil
levant qui, dans leurs pensées, éclairait en même temps l’Inde et la
Réunion.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Chevre Savanah HistoireDokument1 SeiteChevre Savanah HistoireFred RocherNoch keine Bewertungen
- Objet Rituel PujaDokument4 SeitenObjet Rituel PujaFred RocherNoch keine Bewertungen
- Cuisine Aux Épices (PDFDrive)Dokument128 SeitenCuisine Aux Épices (PDFDrive)moha mohNoch keine Bewertungen
- Courbe de Croissance Chevre BoerDokument1 SeiteCourbe de Croissance Chevre BoerFoto KovilNoch keine Bewertungen
- GulikaDokument4 SeitenGulikanicolasNoch keine Bewertungen
- Veronique Dasen - Le Langage Divinatoire Du CorpsDokument20 SeitenVeronique Dasen - Le Langage Divinatoire Du Corpsbreton_nadja2269100% (1)
- Astrologie Indienne - 01 Planetes1Dokument2 SeitenAstrologie Indienne - 01 Planetes1nicolasNoch keine Bewertungen
- Beaujard - Devins-Gua RDokument21 SeitenBeaujard - Devins-Gua RANDRE AURELLIONoch keine Bewertungen
- Dhanvantari PujaDokument13 SeitenDhanvantari PujafelefelNoch keine Bewertungen
- La Religion Balinaise Dans Le Miroir de L'hindouisme.Dokument25 SeitenLa Religion Balinaise Dans Le Miroir de L'hindouisme.Tiffany BrooksNoch keine Bewertungen
- Demain 9ème Année No. 8, 02 1935Dokument44 SeitenDemain 9ème Année No. 8, 02 1935JanitaireNoch keine Bewertungen
- Mantras de Ganesh - Atharva ShirshaDokument6 SeitenMantras de Ganesh - Atharva ShirshaTihuakaNoch keine Bewertungen
- PDF Kalki PuranaDokument86 SeitenPDF Kalki PuranaJules VéNoch keine Bewertungen
- Les 18 Ethnies de MadagascarDokument4 SeitenLes 18 Ethnies de MadagascarPatrick RavelomanantsoaNoch keine Bewertungen
- Les Mœurs Et Coutumes - Fonds Patrimoniaux de L'oiDokument171 SeitenLes Mœurs Et Coutumes - Fonds Patrimoniaux de L'oiasorotany100% (1)
- Mythologie JaponaiseDokument137 SeitenMythologie JaponaiseDaniel MoukouriNoch keine Bewertungen
- P Antes A Romatiques Médicinales: MadagascarDokument180 SeitenP Antes A Romatiques Médicinales: MadagascarRahobinirinaNoch keine Bewertungen
- Cousins, William Edward. 1897. Introduction Sommaire À L'étude de La Langue Malgache.Dokument100 SeitenCousins, William Edward. 1897. Introduction Sommaire À L'étude de La Langue Malgache.AymericDM100% (3)
- Les Prieres Aux Dieux de La NuitDokument138 SeitenLes Prieres Aux Dieux de La NuitninzuNoch keine Bewertungen
- Demain 8ème Année No. 8, 01 1934Dokument28 SeitenDemain 8ème Année No. 8, 01 1934JanitaireNoch keine Bewertungen
- Demain 9ème Année No. 2, 07-08 1934Dokument28 SeitenDemain 9ème Année No. 2, 07-08 1934JanitaireNoch keine Bewertungen
- La Medecine Dans L Antiquite Grecque Et RomaineDokument142 SeitenLa Medecine Dans L Antiquite Grecque Et Romaineantonio59100Noch keine Bewertungen
- 5 Oiseaux AstrologieDokument2 Seiten5 Oiseaux AstrologieFoto KovilNoch keine Bewertungen
- Zahan - Antilope Du SoleilDokument5 SeitenZahan - Antilope Du SoleilMbock Louta0% (1)
- Halbronn, JacquesDokument115 SeitenHalbronn, Jacqueshighrange100% (1)
- Saraswati UpanishadDokument6 SeitenSaraswati UpanishadGovind Chandra DwivediNoch keine Bewertungen
- LA FOI Malgache Cosmogonie, Théologie Et Anthropologie: Louis MOLETDokument844 SeitenLA FOI Malgache Cosmogonie, Théologie Et Anthropologie: Louis MOLETRJ AntyNoch keine Bewertungen
- Histoire Des AstresDokument547 SeitenHistoire Des AstresAdama KONENoch keine Bewertungen
- Sikidy Cours 2Dokument42 SeitenSikidy Cours 2MaminirinaNoch keine Bewertungen
- Étapes Préparatoires Au Puja en Six ÉtapesDokument16 SeitenÉtapes Préparatoires Au Puja en Six ÉtapesFred Rocher100% (1)
- Cadran SolaireDokument34 SeitenCadran Solairesloane10Noch keine Bewertungen
- Demain 13ème Année No. 3, 07 1938 09 1938Dokument56 SeitenDemain 13ème Année No. 3, 07 1938 09 1938JanitaireNoch keine Bewertungen
- Yantra ShriDokument84 SeitenYantra Shriimdougoud7136100% (1)
- 2 - Histoire 6è - Les Sources de L'histoireDokument4 Seiten2 - Histoire 6è - Les Sources de L'histoireLazéni KoulibaliNoch keine Bewertungen
- Deschamps, Hubert. 1936. Le Dialecte Antaisaka.Dokument126 SeitenDeschamps, Hubert. 1936. Le Dialecte Antaisaka.AymericDM100% (1)
- Andolo PDFDokument244 SeitenAndolo PDFErica Nomenjanahary PrincyNoch keine Bewertungen
- Homam FrenchDokument36 SeitenHomam FrenchPatrick BomaneNoch keine Bewertungen
- Sanatan DharmaDokument180 SeitenSanatan DharmaChristian BeaudouxNoch keine Bewertungen
- Glossaire Bilingue de L e CommerceDokument89 SeitenGlossaire Bilingue de L e CommerceJean-Jacques Daubie100% (1)
- Rudraksha Jabala Upanishad PDFDokument10 SeitenRudraksha Jabala Upanishad PDFJuliano CostaNoch keine Bewertungen
- Haya Griva UpanishadDokument5 SeitenHaya Griva UpanishadKitty KongNoch keine Bewertungen
- Marre, Aristide. 1909. Vocabulaire Des Mots D'origine Européenne Présentement Usités Dans La Langue Malgache.Dokument43 SeitenMarre, Aristide. 1909. Vocabulaire Des Mots D'origine Européenne Présentement Usités Dans La Langue Malgache.AymericDMNoch keine Bewertungen
- Demain 54ème Année No. 15, 1er Trimestre 1980Dokument56 SeitenDemain 54ème Année No. 15, 1er Trimestre 1980JanitaireNoch keine Bewertungen
- Production Du MielDokument4 SeitenProduction Du MielDagbéto Ben-DoniNoch keine Bewertungen
- L'écriture Du SanskritDokument13 SeitenL'écriture Du Sanskritsergio2385100% (1)
- Synthèse D Un SavonDokument3 SeitenSynthèse D Un SavonAbdou BenzinebNoch keine Bewertungen
- #Les Périodes Indiennes Des Cycles Et Des ViesDokument5 Seiten#Les Périodes Indiennes Des Cycles Et Des ViesAivlysNoch keine Bewertungen
- Demain 12ème Année No. 6, 10-12 1937Dokument66 SeitenDemain 12ème Année No. 6, 10-12 1937JanitaireNoch keine Bewertungen
- 1008 Ayyapan Francais ExplikeDokument39 Seiten1008 Ayyapan Francais ExplikeFoto KovilNoch keine Bewertungen
- 01Dokument20 Seiten01joker63000Noch keine Bewertungen
- Recettes créoles de Da ti Clé: Par Mamie Clémence JEAN-LOUISVon EverandRecettes créoles de Da ti Clé: Par Mamie Clémence JEAN-LOUISNoch keine Bewertungen
- Marie Etienne Peroz Partie2Dokument110 SeitenMarie Etienne Peroz Partie2Yves MonteilNoch keine Bewertungen
- Les aventures d'un négrier: Trafiquant d'or, d'ivoire et d'esclavesVon EverandLes aventures d'un négrier: Trafiquant d'or, d'ivoire et d'esclavesNoch keine Bewertungen
- Intro Histoire BurkinaDokument6 SeitenIntro Histoire BurkinaBonzimeNoch keine Bewertungen
- 8000 Morts Matadi Leopoldville - HoffmannDokument5 Seiten8000 Morts Matadi Leopoldville - HoffmannVictor RosezNoch keine Bewertungen
- Histoire Geo PDFDokument64 SeitenHistoire Geo PDFGRT67% (3)
- Esclaves Olivier GrenouilleauDokument260 SeitenEsclaves Olivier GrenouilleauMozart FeronNoch keine Bewertungen
- Histoire Afrique: Comptoirs Des Villes Coloniales Au SénégalDokument366 SeitenHistoire Afrique: Comptoirs Des Villes Coloniales Au SénégalPascal Gibert100% (1)
- DOCUMENTS Raite - en - AfriqueDokument1 SeiteDOCUMENTS Raite - en - AfriqueRow MskNoch keine Bewertungen
- Histoire Geographie: Producteur Distributeur ExclusifsDokument130 SeitenHistoire Geographie: Producteur Distributeur ExclusifsAbdoulaye KoneNoch keine Bewertungen
- Fiche 4H1 Commerce Triangulaire VFDokument7 SeitenFiche 4H1 Commerce Triangulaire VFguicbogossNoch keine Bewertungen
- F. Engels - Le Role de La Violence Dans L'histoire PDFDokument101 SeitenF. Engels - Le Role de La Violence Dans L'histoire PDFEliseo HENoch keine Bewertungen
- Histoire de L'afrique 2 L'Afrique (... ) Cornevin Robert Bpt6k5611285tDokument636 SeitenHistoire de L'afrique 2 L'Afrique (... ) Cornevin Robert Bpt6k5611285tולדימיר מרטין סנטNoch keine Bewertungen
- Les Ethnies de La Cote DDokument2 SeitenLes Ethnies de La Cote DYaha Messou ThotNoch keine Bewertungen
- PAROLES de La MarseillaiseDokument4 SeitenPAROLES de La Marseillaisemexico8609Noch keine Bewertungen
- Couleur Cubaine PDFDokument13 SeitenCouleur Cubaine PDFRoxane BourgeoletNoch keine Bewertungen
- Serviteurs InutilesDokument1 SeiteServiteurs InutileskiamgoNoch keine Bewertungen
- De Saint-Domingue A Haiti - Hegemonie Francaise Et Lutte Pour L IndependanceDokument16 SeitenDe Saint-Domingue A Haiti - Hegemonie Francaise Et Lutte Pour L IndependanceNephtalie PrévalNoch keine Bewertungen
- L Ile de GoreeDokument7 SeitenL Ile de GoreeCastro FidèleNoch keine Bewertungen
- The Destruction of Black CivilizationDokument193 SeitenThe Destruction of Black CivilizationBoyandGirlink Maya100% (7)
- Conquête de La Liberté, Mutations Politiques, Sociales Et Religieuses en Haute Casamance - Les Anciens Maccube Du Fuladu (Région de Kolda, Sénégal)Dokument24 SeitenConquête de La Liberté, Mutations Politiques, Sociales Et Religieuses en Haute Casamance - Les Anciens Maccube Du Fuladu (Région de Kolda, Sénégal)Aliou DIAMANKA100% (1)
- Pick A Bale of CottonDokument1 SeitePick A Bale of CottonSilvia TelloliNoch keine Bewertungen
- Enviando 03 Vodoun FonDokument55 SeitenEnviando 03 Vodoun FonVoduno Zodaavi100% (1)
- Toussaint Louverture: Les Douze Facettes de Son Génie Par Leslie F. ManigatDokument8 SeitenToussaint Louverture: Les Douze Facettes de Son Génie Par Leslie F. Manigatjean_juniorjNoch keine Bewertungen
- Jean-Pierre Langellier - Léopold Sédar SenghorDokument450 SeitenJean-Pierre Langellier - Léopold Sédar Senghorsoul badieNoch keine Bewertungen
- l'OUVERTURE ATLANTIQUEDokument22 Seitenl'OUVERTURE ATLANTIQUEAnonymous HLBjNdHuNoch keine Bewertungen
- Voltaire Candide Analyse LinéaireDokument4 SeitenVoltaire Candide Analyse LinéaireAdeleNoch keine Bewertungen
- CASSIN Barbara - Eloge de La TraductionDokument258 SeitenCASSIN Barbara - Eloge de La TraductionSenda Sferco100% (2)
- Apropos Tifinagh PDFDokument20 SeitenApropos Tifinagh PDFDuveyrierNoch keine Bewertungen
- Mineria Hispanica e IberoamericanaDokument16 SeitenMineria Hispanica e IberoamericanaHueytlacaelelNoch keine Bewertungen
- Viagem Pitoresca Ao Brasil, de DebretDokument210 SeitenViagem Pitoresca Ao Brasil, de DebretBreno FernandesNoch keine Bewertungen
- DevoirDokument1 SeiteDevoirapi-424476507Noch keine Bewertungen
- PDF L Empire Mamelouk D EgypteDokument5 SeitenPDF L Empire Mamelouk D EgypteMohamed BouykorranNoch keine Bewertungen